Lire et télécharger en format PDF
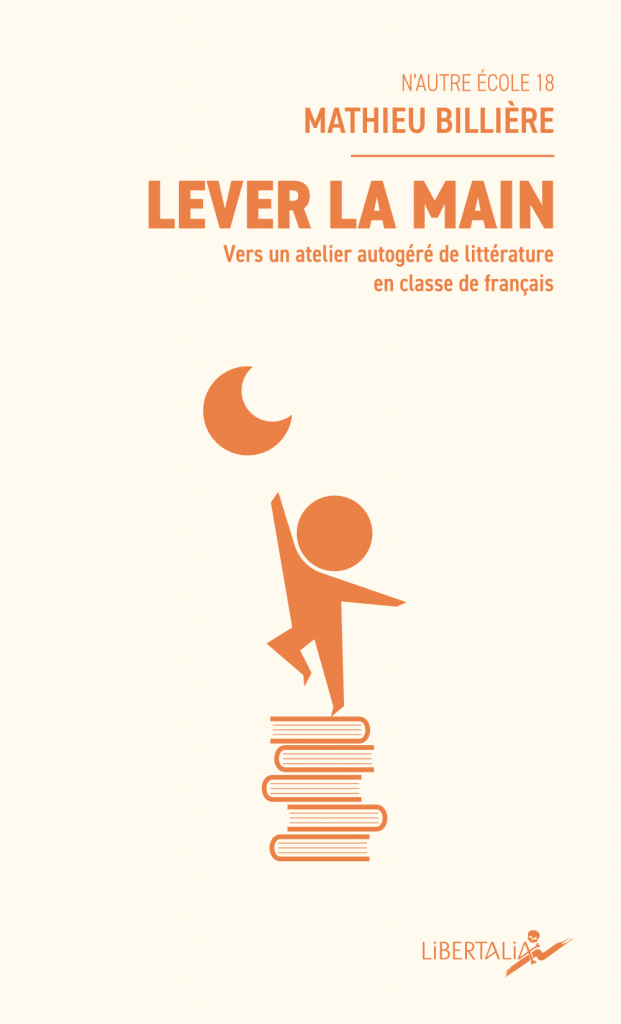 Lever la main : vers un atelier autogéré de littérature en classe de français, de Mathieu Billière, éditions Libertalia 2025
Lever la main : vers un atelier autogéré de littérature en classe de français, de Mathieu Billière, éditions Libertalia 2025
240 pages — 10 €
Parution : 2 septembre 2025
ISBN physique : 9782377293933
ISBN numérique : 9782377293940
Note de lecture de Dominique Bucheton. 22/10/2025
Il faut lire, relire, relire encore le livre de Mathieu Billière : Lever la main. C’est un grand livre, rare, dense, écrit à la première personne, non celle d’un narrateur mais d’une conscience professionnelle qui s’interroge, nous interroge. Une parole et une auto-analyse singulière ; celle d’un acteur, un enseignant qui raconte, questionne, explore dans le détail les fondements théoriques, éthiques, didactiques, politiques de sa pratique, de ce qu’il nomme : « l’atelier autogéré de littérature », ses diverses étapes, tous les écrits et oraux intermédiaires qu’il multiplie. Un enseignant qui questionne son rôle éducatif dans l’institution, ses responsabilités envers les élèves. Un récit dans la classe, avec les élèves, au cœur de batailles interprétatives avec le Cid, madame Bovary, Maupassant, Maryse Condé, Roméo et Juliette, un poème de Chénier qui suscita bien des controverses, etc.
Un livre de combat : de résistance à l’institution, ses programmes, évaluations, injonctions ineptes, rétrogrades, dangereuses. Un « Non « ! ferme au nouveau management asservissant tant pour les enseignants que pour les élèves. Un refus de la réduction de pratiques de classe à des technicismes, des modelages méthodiques de la pensée, des savoirs réduits à leur simple valeur marchande pour la grande compétition qu’est devenu Parcoursup.
C’est surtout un livre optimiste pour combattre la souffrance des enseignants empêchés de faire leur métier en conscience, en liberté ; une manière d’affirmer haut et fort : non on n’est pas obligé d’accepter de laisser détruire le métier, d’abandonner l’idée de faire de nos élèves des lecteurs de littérature, des esprits autonomes, critiques, des êtres sociaux qui se parlent, s’écoutent. Soyons rusés, inventifs, faisons confiance aux élèves et à leur capacité de développement.
Mais voyons de plus près, ce grand récit d’expérience et engagement professionnel. On y rencontre plusieurs personnages : des acteurs qui ne cessent de se croiser, s’opposer, s’interpeller, conjuguer ou compliquer leus actions.
Le premier personnage c’est La LITTERATURE. Elle est ici, dans la classe de français, pensée, travaillée, non pas seulement comme un objet patrimonial, culturel à brandir dans des oraux ou salons, mais un instrument culturel essentiel pour rencontrer le monde, se frotter fictionnellement à lui, ouvrir une conversation avec soi-même et plus encore avec les autres. Elle est d’abord une pratique : LIRE ! Mais, pour aller plus loin que la rencontre première avec le texte, pour comprendre la force et la puissance de la littérature, celle des mots qui nous parlent, nous émeuvent, il faut aussi des outils réflexifs. Ce sont les savoirs littéraires, culturels, historiques, linguistiques, etc., Ils permettent de mettre à distance cette première lecture, comprendre la singularité et l’universalité parfois d’une œuvre.
Le deuxième personnage central du récit c’est la classe ! La classe comme sujet collectif. C’est sans doute là, en sciences de l’éducation, en psychologie sociale ou et cognitive, une question encore insuffisamment traitée. Elle est d’importance à une époque où tout est fait pour désocialiser les individus, les isoler, dans leurs petites préoccupations ou projets personnels. La classe que la réforme du lycée et ses multiples spécialités a voulu casser ! Mathieu Billière parle ici de la classe comme d’un atelier où on pense ensemble, on expérimente, on fabrique, ensemble, le sens de la littérature, celui spécifique, souvent pluriel du texte qu’on étudie en s’exerçant à de multiples controverses, questions posées au texte, partage d’écritures, paperolles, collages, tableaux, journal personnel. Une classe qu’on peut aussi penser comme un laboratoire, où chacun apporte sa recherche ses savoirs pour répondre à un problème à résoudre. Les élèves y sont des chercheurs où chacun existe parce qu’il est écouté par les autres, qui reste auteur autonome d’une pensée, interprétation singulière laquelle s’est construite par, avec et contre le collectif. L’émancipation est à ce prix ! c’est une conquête rude.
Un troisième personnage agit constamment en arrière-plan, guide l’action de l’enseignant : c’est le principe éthique, démocratique, d’émancipation des élèves. Il présuppose que la pensée, l’esprit critique, la citoyenneté comme activité et responsabilité partagée ne peuvent se développer que dans un contexte, des espaces démocratiques où la parole de chacun est entendue et partagée, discutée. Elle s’éteint dans des espaces scolaires ou la concurrence, le contrôle constant devient l’organisateur premier pour les élèves, leurs familles.
Le quatrième personnage, l’enseignant est lui aussi omniprésent, mais le plus possible en coulisse, en tacticien et observateur de l’avancée de la réflexion. En posture de retrait le plus possible après avoir soigneusement préparé le terrain. En maitre du temps il sait combien le temps, l’importance des écrits et oraux intermédiaires et multiples se succédant, se nourrissant sont des gestes d’étude premiers pour la mise en activité, l’engagement et la réussite de tous les élèves. Non il ne donnera pas son interprétation pour les textes de l’oral du bac et quand il interrogera il vérifiera si une pensée singulière se manifeste. L’enseignant n’est là, quasiment plus jamais, en posture magistrale mais pour l’essentiel en posture d’accompagnement. Un vrai combat là aussi, parfois contre soi-même.
Un cinquième personnage inattendu se glisse dans la fin du livre : la dissertation. S’agit-il d’une provocation après avoir pourfendu les exercices scolaires que les élèves peuvent faire à peu de frais avec des plans standards, des argumentations attendues ? Rien de cela, Mathieu Billière défend fermement la dissertation, une forme scolaire d’écriture qui doit être l’aboutissement d’une réflexion personnelle, d’une parole singulière d’auteur qui s’autorise à donner son point de vue. Il s’agit alors d’investir l’écriture de la dissertation comme pratique créative exigeante ! Mais il y faut beaucoup de temps, de strates préparatoires ! Une pratique émancipatrice qu’on refuse aujourd’hui aux élèves de la voie professionnelle.
On l’aura compris, ce livre est une ode à l’émancipation et la responsabilité des enseignants de français. Osez, soyez créatifs, résistez, soyez fidèles à toute la culture professionnelle, aux recherches sur la littérature, en didactique, pédagogie. Les adultes ne lisent plus beaucoup. Relevons les défis devant nous !
- Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
